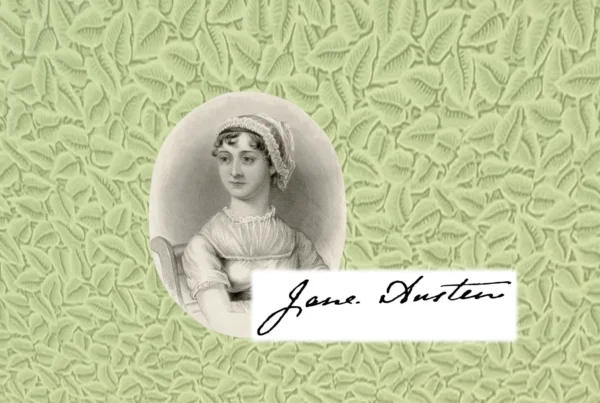Faire bouillir les homards vivants, couper les pattes des crabes, entasser les crustacés dans des bassins. La législation sur le bien-être animal ne protège pas ces animaux de ce sort cruel. Pourquoi ? Parce que l’on croit que les crustacés, tels que les crabes, les homards et les crevettes, sont incapables de ressentir la douleur. Une nouvelle étude révolutionnaire prouve le contraire. Non seulement les crustacés ressentent la douleur, mais ils se souviennent des expériences douloureuses passées et en tirent des leçons. Ces animaux ne sont pas de simples créatures réactives, mais des êtres sensibles.
Lukas Barcherini Peter
17 février 2025
English version | German version
Pendant de nombreuses années, on a supposé que les crustacés n’étaient pas capables de ressentir la douleur en raison de leur système nerveux décentralisé. Contrairement aux mammifères, qui possèdent un système nerveux centralisé, composé du cerveau et de la moelle épinière, les crustacés s’appuient sur des ganglions. Ces ganglions sont des groupes de cellules nerveuses réparties sur l’ensemble du corps. Cette configuration a été jugée trop simple pour permettre le traitement complexe nécessaire à la douleur subjective. Leurs réactions à des stimuli nocifs, tels que le pincement ou l’exposition à des produits chimiques, étaient traditionnellement considérées comme des réflexes, c’est-à-dire des réponses automatiques et inconscientes visant à éviter un dommage immédiat. Cependant, ces hypothèses ne sont peut-être plus valables.
Dans leur étude novatrice, les chercheurs de l’Université de Göteborg ont choisi les crabes de rivage comme espèce représentative, car leur physiologie et leur comportement reflètent étroitement ceux des autres crustacés (Kasiouras E, Hubbard PC, Gräns A, Sneddon LU. Putative Nociceptive Responses in a Decapod Crustacean : The Shore Crab (Carcinus maenas). Biology (Basel), octobre 2024).
L’étude suédoise a été la première à doter les crustacés de dispositifs de mesure neuronale. Les crabes ont été soumis à des tests contrôlés impliquant des stimuli mécaniques et chimiques. Une pression mécanique a été appliquée aux tissus mous, tandis que des acides faibles ont été utilisés pour stimuler chimiquement les muqueuses. Des électrodes, semblables à celles utilisées dans un EEG (électroencéphalographie), ont enregistré l’activité électrique dans le système nerveux des crabes, offrant une vue détaillée de la façon dont ces stimuli étaient traités. L’EEG est une méthode d’enregistrement de l’activité électrique spontanée du cerveau.
Les résultats de l’étude ont été surprenants. Les scientifiques ont prouvé que les crustacés possèdent des nocicepteurs, c’est-à-dire des récepteurs de la douleur. Avant cette étude, on supposait que les crustacés ne possédaient pas ces récepteurs de la douleur, qui sont présents dans le corps humain.
Le test EEG a montré que les réponses neuronales varient considérablement en fonction du type de stimulus. La pression mécanique provoque des bouffées d’activité brèves mais intenses, tandis que les stimuli chimiques déclenchent des réponses prolongées et de moindre intensité. Cette distinction suggère que le système nerveux des crabes traite différents types de dommages de manière appropriée au contexte, plutôt que d’avoir un réflexe unique. Cette complexité reflète la façon dont les animaux supérieurs, y compris l’homme, traitent les signaux de type douleur.
Les résultats de l’étude montrent que le comportement des crabes témoigne d’un apprentissage et d’une mémoire. Après avoir subi des stimuli nocifs, les crabes évitent activement les zones ou les situations associées à ces expériences. Par exemple, un crabe exposé à l’inconfort et aux blessures dans un endroit spécifique évitera par la suite de retourner à cet endroit. Cet ajustement comportemental indique que les crabes se souviennent de l’expérience et adaptent leurs actions pour éviter de nouvelles blessures. Les réflexes, en revanche, ne font pas appel à la mémoire ou à l’apprentissage.
L’étude a également mis en évidence des comportements de protection délibérés. Les crabes se toilettent ou se frottent sur les zones exposées à des stimuli nocifs, des actions qui ressemblent à des tentatives d’atténuation de l’inconfort. Les crabes préféraient tolérer des dommages mineurs pour éviter des risques plus importants, tels que la prédation. Cette capacité à évaluer les risques et les coûts implique un niveau de traitement cognitif qui va au-delà des réflexes automatiques.
Ces résultats concordent avec d’autres études scientifiques qui suggèrent que les crustacés ne sont pas simplement des organismes réactifs, mais qu’ils possèdent un certain degré de sensibilité. Ces études ont montré que les crustacés exposés à des substances irritantes, telles que l’acide acétique, s’engagent souvent dans des actions de protection ou affichent des préférences pour éviter la source du dommage.
Cependant, bien que les preuves suggèrent fortement que les crustacés éprouvent des sensations semblables à la douleur, il n’est pas certain qu’ils ressentent la douleur au sens où l’entendent les humains. Chez l’homme, la douleur implique non seulement la détection d’un dommage, mais aussi des composantes émotionnelles et cognitives qui rendent l’expérience désagréable. Les résultats actuels indiquent un niveau de traitement chez les crustacés qui remet en question leur classification traditionnelle comme insensibles, mais ne permettent pas d’assimiler complètement leur expérience à la douleur ressentie par les mammifères, y compris l’homme.
Les crustacés restent exclus de la législation sur le bien-être animal, bien qu’il soit de plus en plus évident que cette exclusion est obsolète. Des pratiques telles que faire bouillir des homards vivants, dégriffer des crabes vivants ou les entasser dans des bassins persistent, en grande partie parce que ces animaux ne sont pas légalement reconnus comme des êtres sensibles. Par exemple, la directive européenne 2010/63/UE ne protège pas les crustacés décapodes, bien que des études comportementales et neurologiques démontrent régulièrement leur capacité à réagir de manière complexe aux agressions. De même, dans de nombreux pays, les industries de la pêche et de l’aquaculture opèrent sans directives éthiques visant à réduire les souffrances potentielles des crustacés.
Cet oubli juridique persiste malgré les preuves scientifiques de plus en plus nombreuses de leur sensibilité. Des études, dont celle menée récemment par des scientifiques de l’université de Göteborg, démontrent de manière irréfutable que les crustacés présentent des comportements et des réactions neurologiques semblables à la douleur, comme ceux observés chez les vertébrés.
Dans certaines juridictions, des progrès ont déjà été accomplis. En 2019, le Royaume-Uni, par exemple, a modifié ses lois sur le bien-être animal pour y inclure les crustacés décapodes, reconnaissant ainsi leur capacité à souffrir sur la base de preuves scientifiques. Cette évolution suggère que les politiques évoluent pour refléter la compréhension croissante de la cognition et de la sensibilité des animaux.
Les résultats les plus récents soulignent les implications profondes de la reconnaissance des crustacés en tant qu’êtres sensibles, ce qui nécessite des changements significatifs dans le traitement de ces animaux dans tous les secteurs. Qu’il s’agisse d’adopter des méthodes d’abattage plus humaines ou de repenser les pratiques d’hébergement et de manipulation, cette reconnaissance exige un changement d’attitude éthique de la part de la société et une réforme législative.
L’étude suédoise met en évidence le besoin urgent d’actualiser des politiques et des pratiques dépassées, en soulignant que combler ces lacunes n’est pas seulement un impératif scientifique, mais aussi une obligation morale.